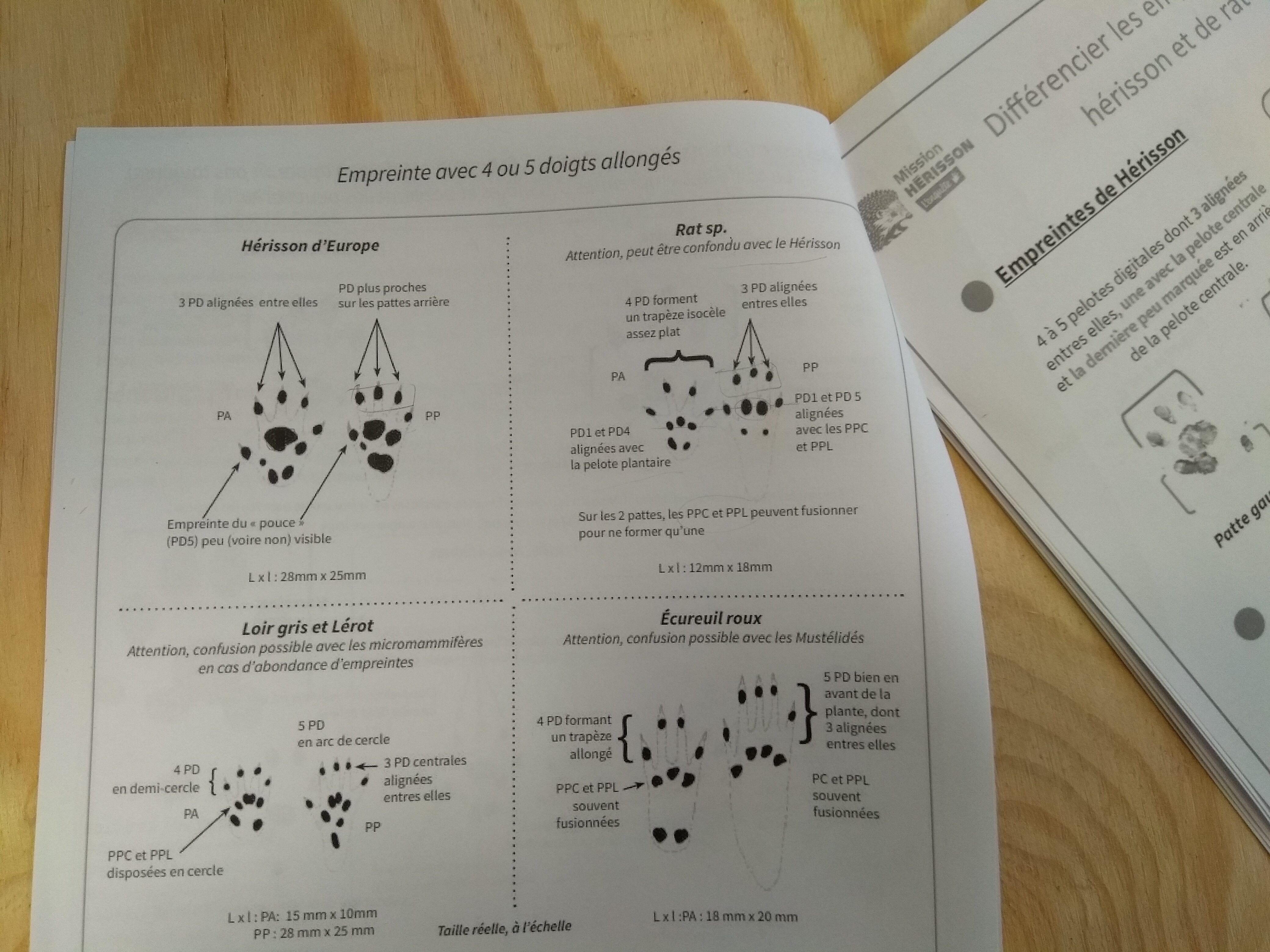Fête de la nature 2021 | Programme des actions de Bretagne Vivante
Jusqu’au 23 mai c’est la Fête de la Nature !
À cette occasion, retrouvez Bretagne Vivante sur des stands et des animations partout en Bretagne.
la Fête de la Nature est l’occasion de vivre une expérience inédite et gratuite au contact de la nature : visites guidées de sites protégés, balades accompagnées dans les grands espaces naturels protégés, exploration des milieux marins, inventaires d’espèces participatifs, jeux de piste… apprêtez-vous à découvrir la nature de Bretagne sous un nouvel angle !
Pour plus d’informations sur l’événement, rendez-vous sur : www.fetedelanature.com/c-est-quoi-cette-fete
Quelques-unes des activités au programme ce week-end :
Samedi 22 mai :
Moisdon-la-Rivière
10h-14h : Balade printanière dans la Lande et au Pays des Forges
Information et réservation sur : urlz.fr/fHgE
Relecq-Kerhuon :
10h30-12h30 : Balade nature dans la Vallée du Costour
Initiation à la faune et la flore sauvage en bords de chemin autour d’informations et d’anecdotes naturalistes. Cette balade sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la vallée du Costour et de partager ses sensibilités au contact de la nature.
Réservation par mail : culture@mairie-relecq-kerhuon.fr
Gouesnou :
14h-15h30 / 15h30-17h : Au fil de la Penfeld
En partant de Gouesnou, nous pouvons parcourir les bords de la Penfeld et (re)découvrir les petits sentiers de bocage, les chemins creux et les nombreux talus et haies environnants. Au travers d’un parcours de découverte du patrimoine naturel, l’objectif est de partir à la découverte de la Penfeld en tant que « zone source ».
Information et réservation sur : www.fetedelanature.com/edition-2021/gouesnou-fete-le-jardin-et-la-penfeld
Dimanche 23 mai :
Plougasnou – La pointe de Primel à la loupe
09h30-12h00 : La marée n’attend pas !
Pas de grasse matinée pour les amoureux de l’estran. Ils ont rendez-vous avec Chloé, l’animatrice de Bretagne Vivante, pour une sortie découverte sur une grève sauvage et particulièrement riche en biodiversité, la plage du camping, à Primel. Algues, mollusques et crustacés à volonté !
Pour tout public. Apportez vos bottes et vos seaux. Réservation auprès de l’Office de Tourisme.
10h00-12h00 : Petits petons et sensations
Au village des associations, sur la pointe de Primel, Bégé, bénévole à Bretagne Vivante, invite les petits petons sur le chemin qu’elle a créé pour eux à partir d’éléments naturels. A parcourir pieds-nus, les yeux ouverts ou les yeux fermés, au choix !
Départs échelonnés, le matin.
Le parcours restera en accès libre l’après-midi. Pour enfants de moins de 6 ans. Sans réservation.
14h30-17h00 : Trésors de fleurs et de papillons
Entomologiste et bénévole à Bretagne Vivante, Philippe vous attend pour une chasse très pacifique de papillons, sauterelles et autres petits trésors, à condition que le soleil soit au rendez-vous. A ses côtés, Yves, son collègue botaniste de Bretagne Vivante, vous fera découvrir les pouvoirs extraordinaires de la flore des bords de mer, capable de s’adapter aux contraintes du vent, des embruns et de la pauvreté du sol. Une balade-observation à deux voix par deux experts passionnés et passionnants, pour poser un regard bienveillant sur l’infiniment petit de la pointe de Primel.
Tout public. Réservation auprès de l’Office de Tourisme.
Information et réservation sur : www.fetedelanature.com/edition-2021/la-pointe-de-primel-la-loupe
Brest – Jardin du conservatoire botanique national (Stang Alar)
14h-18h :
- Stand observation des oiseaux d’eau
Découvrir et apprendre à observer les oiseaux, c’est porter un autre regard sur le Stang Alar. Venez vous initier à l’ornithologie. Les longues vues à disposition vous permettront de faire le plein de sensation.
- Découverte des odonates
Aéronefs, hélicoptères ou zygoptères ? Elles passent leur vie entre deux mondes, qui sont ces insectes qui peuplent nos plans d’eau et leurs berges ? De leurs premiers jours aquatiques à leur fin de vie aérienne, venez découvrir l’univers fascinant des libellules et des demoiselles
- Rallye Nature
Jeu grandeur nature où questions, énigmes et missions rythment le parcours. Ce format ludique permet une découverte accessible et attrayante du Stang Alar. Entre amis ou en famille, les épreuves amèneront à réfléchir autant sur la faune et la flore ordinaires, que sur des espèces protégées.
- Atelier d’initiation à la botanique
Balade botanique autour des plantes sauvages du Vallon. Loupe, véritable amie du botaniste, à disposition pour explorer le monde fascinant des plantes et s’initier à leur reconnaissance.
- Stand associatif
Rencontre avec les bénévoles de l’association. Présentation des activités, des sorties et des groupes thématiques.
Plus d’informations sur : www.fetedelanature.com/edition-2021/fetons-la-nature-au-conservatoire-botanique-national-de-brest